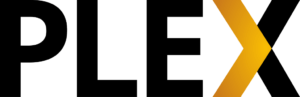Résumé
Russie, au début des années 1990, au lendemain de l'effondrement de l'URSS. Dans un nouveau monde qui promet la liberté et flirte avec le chaos, un jeune artiste devenu producteur de télévision, Vadim Baranov, devient de manière inattendue le spin doctor d'un membre prometteur du FSB (ex-KGB), Vladimir Poutine.
Avis CinéSam (film vu le : 28/01/2026)
Je suis sorti de la projection du Mage du Kremlin avec un sentiment partagé, à mi-chemin entre la fascination pour ce que le film raconte et une certaine lassitude devant la manière dont il le fait 😐. J’ai encore en tête The Apprentice sur Donald Trump, et je ne peux pas m’empêcher de voir ce Mage du Kremlin comme son pendant russe, une autre plongée dans les coulisses du pouvoir où la fiction avec des éléments de réalité sert d’écran déformant à l’Histoire récente. Ici, Olivier Assayas met en scène l’ascension de Vladimir Poutine à travers le regard de Vadim Baranov, conseiller de l’ombre interprété par Paul Dano, figure inspirée mais jamais explicitement désignée comme un double de Surkov, ce qui renforce ce vertige entre vrai et faux qui irrigue tout le film. J’ai aimé cette manière de ne jamais totalement trancher, de laisser au spectateur le soin de démêler ce qui relève du document et ce qui relève du roman, surtout en sachant que tout vient d’un livre éponyme de Giuliano Da Empoli, lui-même nourri par une observation intime des élites politiques.
L’ancrage dans la réalité, Assayas l’assume en sélection officielle à la Mostra de Venise, où le film a été présenté en compétition, comme un geste politique autant qu’artistique 🎬. On sent que le cinéaste retrouve ici son goût pour les zones grises du contemporain, comme il l’avait déjà fait dans d’autres œuvres, mais avec une ambition plus frontale, presque programmatique, qui colle bien à ce contexte de festival international où l’on scrute la géopolitique à travers le prisme du cinéma. Ce qui m’a particulièrement frappé, c’est cette volonté de raconter près de trois décennies d’histoire russe à travers un seul regard, celui de ce « mage » qui tire les ficelles dans l’ombre du Kremlin, assumant que la grande Histoire n’est qu’un récit construit, un storytelling auquel Assayas vient opposer son propre récit de cinéma. Le fait que le film soit tourné intégralement en anglais, alors même qu’il ne met en scène que des personnages russes ou presque, s’inscrit aussi dans cette logique de diffusion mondiale du récit, même si ce choix m’a paru étrange, voire légèrement artificiel, surtout dans les scènes les plus intimes où l’on aurait attendu la rugosité de la langue russe 🧐.
L’étrangeté de cette langue unique, l’anglais, crée un léger décalage permanent : je vois des oligarques russes, des conseillers politiques, Poutine lui-même, mais je les entends tous parler dans un anglais lisse, calibré pour l’exportation, ce qui finit par me sortir du film par moments. Je comprends le choix industriel et artistique – casting international, diffusion mondiale, coproduction – mais il accentue la sensation de fiction occidentale sur la Russie plutôt qu’une immersion de l’intérieur, surtout quand le film prétend nous faire entrer dans les arcanes les plus secrètes du pouvoir. Cela dit, ce même choix crée aussi des moments de trouble intéressants, notamment lorsque Jude Law, physiquement transformé pour incarner Vladimir Poutine, glisse dans une diction glaçante qui, même en anglais, restitue quelque chose de la froideur et du contrôle absolu de la figure réelle 😶. Cette distance linguistique devient presque un commentaire en soi : ce que nous voyons n’est pas la Russie, mais une projection occidentale de la Russie, une mise en récit qui assume son filtre, tout en jouant sur notre désir de « vérité ».
Olivier Assayas, en tant que réalisateur français, signe ici un film très classique dans sa forme, presque académique, malgré un sujet brûlant et potentiellement explosif. Je retrouve son goût du découpage précis, du travail sur les intérieurs, des dialogues qui avancent par petites inflexions plutôt que par grands effets de manche, mais j’ai aussi le sentiment qu’il se met volontairement au service du roman de Giuliano Da Empoli, au point de s’enfermer dans une adaptation très littérale. On sent la co-écriture avec Emmanuel Carrère, autre figure de la frontière entre fiction et réel, et pourtant, le film reste étonnamment sage, presque trop poli pour le type de matière qu’il manipule, comme s’il avait peur de basculer dans le pur thriller politique ou au contraire dans la satire plus acide. Du coup, je le trouve relativement bon, honnête, solide, mais rarement renversant : un film qui tient bien la route, mais qui, à mes yeux, manque de cette fulgurance formelle ou émotionnelle qui aurait justifié de le porter comme un grand geste de cinéma contemporain 🤔.
Le découpage en chapitres structure clairement le récit, comme si Assayas assumait la nature romanesque du matériau d’origine, et je dois dire que cette segmentation m’a à la fois aidé à suivre la chronologie et parfois fatigué. Chaque chapitre ouvre une nouvelle étape dans l’ascension de Poutine et la plongée de Vadim Baranov dans les mécanismes de l’influence, mais le film est long – plus de deux heures vingt – et je l’ai ressenti physiquement, surtout dans son dernier tiers où la répétition des stratégies de manipulation finit par se faire sentir 🕰️. Ce choix de construction fragmentée rappelle celui du roman, qui (selon les sources que j’ai consulté, car je n’ai pas lu le livre) était déjà une succession de tableaux, de souvenirs et de scènes clés, mais le cinéma supporte moins bien cette accumulation, surtout quand la mise en scène reste relativement sobre. J’aurais apprécié que certains chapitres soient resserrés, que le film ose des ellipses plus radicales, quitte à perdre quelques détails, pour gagner en tension et en impact dramatique.
Les images d’archives jouent un rôle important dans le dispositif, créant des ponts entre la fiction et les moments réels de l’histoire russe contemporaine 📺. À chaque fois qu’Assayas insère ces extraits documentaires, le film se densifie, il me rappelle que derrière ce récit stylisé se trouvent des guerres, des élections truquées, des répressions bien concrètes, et que Vadim Baranov n’est qu’une incarnation fictive d’un système bien réel. Ce mélange d’archives et de reconstitution fonctionne plutôt bien, mais il renforce aussi l’impression de regarder une grande fresque pédagogique, comme si le film voulait m’expliquer comment on fabrique un autocrate, étape par étape, en liant les images que je connais aux coulisses que je ne connais pas. Là encore, je suis pris entre l’admiration pour la clarté du propos et une certaine frustration de voir la mise en scène se cantonner à un registre démonstratif plus que viscéral.
Côté casting, le film est très généreux, et c’est probablement l’un de ses plus beaux atouts 😍. Paul Dano, dans le rôle de Vadim Baranov, porte littéralement la narration sur ses épaules, incarnant ce personnage de spin doctor passé de jeune artiste à stratège politique avec une retenue inquiétante : son regard semble constamment calculer, peser chaque mot, chaque image, comme s’il montait en temps réel le film de la Russie. Cela ne m’a pas empêché de le trouver un peu lisse tout de même, image qu’il me renvoie souvent. Jude Law, lui, compose un Vladimir Poutine glaçant, totalement habité, physiquement transformé, qui n’a pas besoin d’en faire trop pour imposer une aura de menace, et j’ai trouvé sa présence à la fois magnétique et profondément dérangeante. Alicia Vikander apporte une dimension plus intime au récit, en Ksenia prise dans ce monde de pouvoir et de cynisme, tandis que Jeffrey Wright, dans un rôle plus mineur, contribue à incarner le regard occidental, celui qui observe, interprète, mais ne maîtrise jamais totalement ce qui se joue sous la surface. Je regrette presque que Wright ne soit pas davantage utilisé, tant son aura pourrait prolonger ce décalage entre la Russie mise en scène et celle fantasmée par le reste du monde.
Un détail m’a particulièrement interpellé : la place du tabac dans les flashbacks, avec des cigarettes et des volutes de fumée qui semblent revenir comme un tic visuel plus que comme un vrai motif signifiant 🚬. J’ai trouvé que cette présence insistante du tabac n’apportait pas grand-chose aux scènes, comme si elle cherchait à colorer l’époque ou à donner un vernis de réalisme sans jamais être réellement interrogée par la mise en scène ou par le récit. D’autant plus qu’à la fin du générique, aucune mention d’ingérence de l’industrie du tabac n’apparaît, ce qui laisse ce motif dans une sorte de flou un peu gênant : simple geste esthétique ou choix inconscient qui banalise la cigarette comme élément de décor. Dans un film aussi conscient de ses enjeux politiques et symboliques, ce manque de cohérence m’a laissé un léger goût d’inachevé sur ce plan précis.
En sortant de la salle, je considère Le Mage du Kremlin comme un relativement bon film, solide, très classique dans sa manière de raconter un sujet pourtant brûlant, mais qui ne dépasse pas, pour moi, le stade du grand film de festival bien tenu 🙂. La mise en scène d’Olivier Assayas reste élégante et maîtrisée, le matériau de Giuliano Da Empoli est passionnant, le mélange de fiction avec des éléments de réalité fonctionne, et le casting – de Paul Dano à Jude Law, en passant par Alicia Vikander et Jeffrey Wright – donne au récit une vraie densité. Mais la longueur, le découpage en chapitres, la langue anglaise omniprésente et certains motifs inutiles comme le tabac dans les flashbacks créent une distance qui m’empêche d’adhérer totalement. Je reste donc à une appréciation mitigée, entre respect pour l’ambition et frustration devant un résultat que je trouve finalement plus sage et plus classique que ce que ce « mage » du Kremlin aurait pu inspirer au cinéma.
Sources : Allociné IMDb La Biennale di Venezia UGC Wikipédia
Autre avis et analyses
Aucun autre avis actuellement. Voulez-vous soumettre le vôtre ? Cliquez-ici !
Critiques en ligne
Bande-annonce et lien Plex
Fiche du film sur les sites grand public